Le courage de l’alpinisme
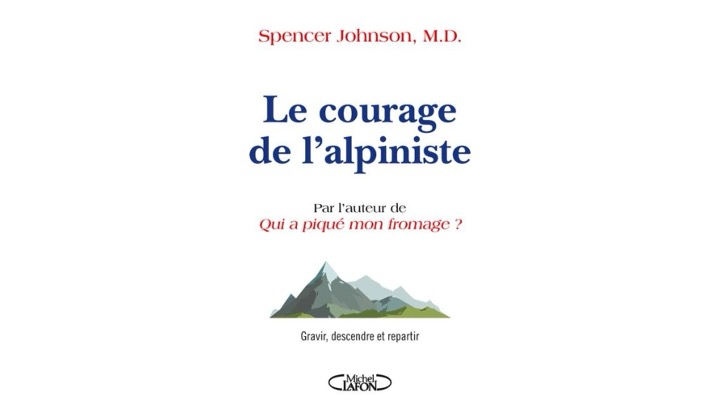
Références:
Johnson, Spencer
Le courage de l’alpinisme : gravir, descendre et repartir
Michel Lafon
2020
Résumé
Spencer Johnson est un habitué des best-sellers : Qui a piqué mon fromage ?, Le Manager Minute et ici Le courage de l’alpiniste (titre original : Peaks and valleys), depuis republié sous un nouveau titre : La Méthode de l’alpiniste.
Tout comme dans Qui a piqué mon fromage ?, l’auteur propose un récit fabuleux, allégorique, sur la manière d’accueillir les hauts et les bas de l’existence et conclut son récit par une forme de mode d’emploi de résilience :
|
Mettre à profit ses sommets et ses vallées Pour bien gérer les hauts et les bas : fais de la réalité ton alliée. Pour quitter plus vite une vallée : trouve et exploite le positif caché sous le négatif. Pour rester plus longtemps sur un sommet : apprécie et gère les jours heureux avec sagesse. Pour atteindre ton prochain sommet : poursuis ta vision sensible. Et pour aider les autres : passe le message ! |
Le récit raconte l’histoire d’un jeune homme à la vie routinière, vie qui lui « procurait un confort rassurant » (2020 : 15). Mais elle s’avérait aussi ennuyeuse, le rendant peu à peu malheureux. De sa vallée, il admirait cependant le sommet des montagnes alentours et finit par se mettre en tête d’y monter. Sauf que « tous tentèrent de le dissuader de s’aventurer là où chacun d’eux ne s’était jamais risqué » (2020 : 17), lui inoculant la peur de l’inconnu. Prenant son courage à deux mains, il finit pourtant par se résoudre à gravir la montagne. Partant tôt un matin, il atteignit le sommet à la nuit tombée, déçu d’avoir raté le coucher du soleil.
C’est là qu’il fit une rencontre, un vieil homme, qui lui inculqua une première leçon, en l’invitant à se coucher parterre ; cela lui permit, en changeant de perspective, d’admirer les étoiles. Ce vieux sage lui proposa alors de lui livrer la « méthode de l’alpiniste », qui consistait à considérer autrement les hauts et les bas de l’existence, à travers les réponses à trois questions (2020 : 22) :
- Comment quitter une vallée plus vite ?
- Comment se maintenir plus longtemps sur un sommet ?
- Comment faire en sorte que les sommets deviennent plus nombreux que les vallées ?
1. Pour bien gérer les hauts et les bas : fais de la réalité ton alliée
En tout premier lieu, « au travail comme dans la vie, les monts et vallées sont aussi naturels qu’inévitables » (2020 : 24) ; les hauts et les bas de l’existence en font aussi la richesse.
Plus encore, ces hauts et ces bas résultent de la manière dont on les perçoit : « Ce que l’on ressent dépend essentiellement du regard que l’on porte sur sa proche situation. Dès lors, le secret consistera à ne pas laisser les événements entacher son estime de soi » (2020 : 27) :
« Les sommets correspondent aux moments où l’on apprécie ce que l’on a. Les vallées, à ceux où l’on se focalise sur ce qu’il manque. » (2020 : 32)
Or, dans les faits, les bons comme les mauvais moments seraient des « cadeaux de l’existence » (2020 : 94) : « Sommets et vallées se distinguent avant tout par leur finalité : les sommets sont faits pour savourer la vie, et les vallées pour l’apprendre » (2020 : 95) :
« La vérité, ce ne sont ni nos peurs ni nos souhaits. C’est tout ce que peuvent nous enseigner les hauts et les bas de l’existence. Désormais, dans les vallées comme dans les hauteurs, je veillerai toujours à traquer la vérité de la situation. » (2020 : 96)
Ainsi, « pour éviter de retomber dans une vallée et conserver le sentiment d’être sur un pic, il faut se concentrer sur les aspects positifs de la situation, en évitant les comparaisons » (2020 : 34) :
« On ne peut pas toujours contrôler les événements. Mais on peut contrôler ses monts et vallées personnels par ses pensées et par ses actes. » (2020 : 35)
2. Pour quitter plus vite une vallée : trouve et exploite le positif caché sous le négatif
De plus, « monts et vallées communiquent. Les erreurs commises quand tout va bien font que bientôt tout ira mal. La sagesse déployée quand tout va mal fait que bientôt tout ira mieux » (2020 : 29) ; pour les mêmes raisons, « il lui suffisait […] de comprendre quels actes l’avaient plongé dans la vallée, puis de faire le contraire pour obtenir le résultat inverse » (2020 : 107).
L’exemple du licenciement est parlant. D’abord, même s’il peut être inquiétant, c’est parfois la meilleure chose qui puisse arriver. Ensuite, en restant positif, on augmente les chances d’être recruté : un recruteur sera plus enclin à engager une personne souriante. Donc, « la sortie de la vallée se dessine lorsque l’on choisit de voir les choses différemment » (2020 : 39). Plus encore :
« On transforme une vallée en sommet en trouvant et en exploitant la part positive de la situation. » (2020 : 41)
C’est fort de ces préceptes que le jeune homme redescendit dans sa vallée, où il reprit une vie ordinaire ; mais en appliquant les préceptes du vieil homme, sa réussite professionnelle fut fulgurante. Or, cette réussite lui monta petit à petit à la tête, perdant l’humilité dont il avait fait preuve en revenant du sommet, et perdant du même coup l’amitié de son entourage, qui se détourna peu à peu de lui. Cette situation n’était pourtant pas surprenante, puisqu’« il n’est pas de monts sans vallées » (2020 : 49). Et « mieux on gère sa vallée, plus vite on atteint le sommet suivant » (2020 : 49).
Face à cette situation d’isolement, le jeune homme devint de plus en plus amer, confirmant ainsi qu’« une vallée qui ne t’enseigne rien te rendra amer. Celle qui t’inculque quelque chose te rendra meilleur » (2020 : 51). Il décida alors d’entreprendre une nouvelle ascension pour retourner auprès du vieux sage et lui demander à nouveau conseil.
3. Pour rester plus longtemps sur un sommet : apprécie et gère les jours heureux avec sagesse
Face au découragement du jeune homme, le vieillard lui rappela d’abord l’importance du regard posé sur les événements. Comme un électrocardiogramme, une vie normale est faite de hauts et de bas ; même les plateaux sont utiles, « puisqu’ils permettent de prendre un peu de recul sur les choses » (2020 : 58) : le repos, la prise de recul, la réflexion, la régénération, sont essentiels.
La prise de recul permet également de ne pas personnaliser les revers de l’existence : « Tu n’es ni tes sommets ni tes vallées. L’individu que tu es ne se réduit pas à ce qu’il traverse » (2020 : 61).
Enfin, ce qui avait plongé le jeune homme dans la morosité n’était pas sa réussite professionnelle, mais son incapacité à gérer cette réussite (par arrogance) : « Les mauvais moments deviennent plus rares lorsque l’on sait gérer les bons avec sagesse » (2020 : 63). L’origine de cette erreur serait l’ego, « qui engendre la peur. C’est lui qui nous rend arrogants sur un sommet et craintifs dans une vallée. L’ego est un prisme déformant » (2020 : 65) :
« La pire ennemie des sommets, c’est l’arrogance déguisée en confiance.
La meilleure alliée des vallées, c’est la peur, maquillée en confort. » (2020 : 66)
Gérer son ego permettrait ainsi de quitter plus vite les vallées et de rester plus durablement aux sommets de l’existence : « L’humilité […] t’aidera à te maintenir sur les hauteurs » (2020 : 94).
4. Pour atteindre ton prochain sommet : poursuis ta vision sensible
Pour revenir au sommet après une descente dans une vallée, le vieux sage lui présenta la méthode de la visualisation, où il s’agit de se fixer un objectif qui doit être réaliste et déclinable à travers les cinq sens, pour le ressentir de manière complète. Pour qu’elle fonctionne, cette méthode doit cependant être articulée à l’action : il faut se mettre en mouvement (« plus investi au travail »).
Fort de ces principes, le jeune homme se fixa un nouvel objectif (sommet) ; il quitta le sommet sur lequel il se trouvait avec le vieux sage, mais pour s’engager dans l’ascension d’un sommet plus haut qu’il distinguait à l’horizon, qui l’attirait et dont il avait visualisé le chemin. La traversée de la vallée qui séparait les deux sommets fut pénible. Pour surmonter ces épreuves, il commença par tenter d’en rire, de les tourner en dérision. Il dut néanmoins reconnaître que la vision sensible qu’il s’était donné avait peu à peu été remplacée par une vision d’horreur, où il se voyait se noyer dans la rivière séparant les deux sommets. Il avait peur :
« Il y avait, en somme, les vallées que l’on subissait sans y pouvoir grand-chose – celle dues à la maladie, au deuil, aux accidents financiers ou autres revers de fortune – et celles que l’on s’infligeait avec ses propres peurs, sans forcément en avoir conscience sur le moment. » (2020 : 80)
Ainsi, si certaines vallées seraient dues à nos zones de contraintes et d’influence, d’autres ne seraient dues qu’à nos attitudes et pensées :
« Sur un sommet, éviter d’embellir la situation. Dans une vallée, éviter de la noircir. Estimer les choses à leur juste valeur, pour faire de la réalité une alliée. » (2020 : 83)
Et la première de ces pensées serait la peur, la peur de l’inconnu, du changement, de l’échec (et d’égratigner son ego), de déplaire… Ainsi, certains rêveraient leur vie, alors que d’autres l’accompliraient, grâce à une vision sensible et au passage à l’action :
« […] Le plus grand obstacle de l’existence, celui qui nous bloque et nous piège, c’est la peur. » (2020 : 95-96)
Il poursuivit son chemin avec ténacité, traversa la rivière et finit par atteindre le sommet qu’il avait visualisé. Et grâce aux enseignements de l’ancien, le jeune voyageur intégra la recette pour durer aux sommets :
« Se montrer humble et reconnaissant.
Continuer de pratiquer ce qui nous a réussi.
Ne jamais cesser d’améliorer les choses.
Faire davantage pour les autres.
Conserver des ressources en prévision de vallées futures. » (2020 : 103)
5. Et pour aider les autres : passe le message !
De retour dans sa vie ordinaire, le jeune homme avait développé une forme de sagesse qu’il ne perdrait plus, contrairement à son premier retour. Il ne commettrait plus les mêmes erreurs : il se mettrait au service des autres plutôt que de cultiver la vantardise ; il veillerait à maintenir une vie équilibrée (« conserver des ressources »), quand bien même elle serait tournée vers l’action. Il retrouva son entreprise, qui était en situation périlleuse, et observa comment les collègues s’étaient enlisés dans un rôle de victime : « Plutôt que d’unir leurs forces pour sauver la compagnie, ils dépensaient leur énergie à chercher des coupables ou à se justifier » (2020 : 100). Cette fois, il sut redresser l’entreprise en évitant les pièges de l’ego : l’arrogance et la peur. Il avait définitivement intégré la « Méthode de l’alpiniste » (cf. encadré ci-dessus).

0 commentaires