La tranquillité de l’âme, suivi de La retraite
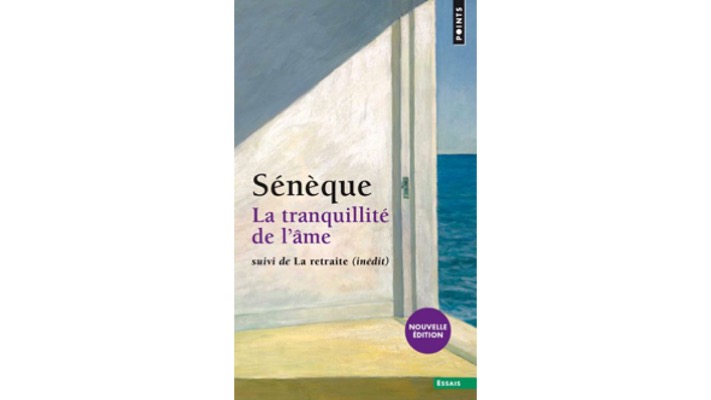
Références:
Sénèque
La tranquillité de l’âme, suivi de La retraite
Essais
2018
Résumé
Poète et philosophe stoïcien du Ier siècle après Jésus-Christ, il fut le précepteur du jeune Néron. Il se retirera peu à peu de la vie publique, partiellement contraint et en partie volontairement. Comme le note Juliette Dross dans sa présentation, il ira jusqu’à demander à Néron de lui retirer son titre honorifique d’« ami du Prince » et de pouvoir lui rendre les biens et terres qu’il avait reçus de sa part (ce qui lui sera refusé). À la suite d’une conspiration à son encontre, Néron souhaitant s’en débarrasser, lui intimera l’ordre de se donner la mort, ce qu’il aurait fait en témoignant d’une grande sérénité (rappelant les suicides contraints de Socrate ou de Canus).
Dans La tranquillité de l’âme (dialogue avec Sérénus – qui tente d’atteindre une forme de tranquillité lui échappant trop souvent), mais également dans La retraite, Sénèque s’interroge sur la manière d’accéder au bonheur, à la sagesse, à la « tranquillité de l’âme », à « ne connaître ni hauts ni bas » (2018 : 49). Il va ainsi thématiser ce qui éloigne et ce qui rapproche de la sérénité. Et si les deux textes peuvent paraître assez décousus, six leçons semblent toutefois pouvoir en être artificiellement ressorties.
Une première leçon pourrait être résumée par « bien choisir ses fréquentations ». Sénèque critique ainsi tous ceux qui « baient aux corneilles » (2018 : 50), qui cultivent l’oisiveté, qui sont indolents et versatiles dans leurs objectifs, car « sans parvenir à réaliser ses désirs, on demeure tout entier accroché à l’espoir de leur réalisation » (2018 : 50) : et une oisiveté mal vécue nourrirait l’envie et la jalousie envers la réussite d’autrui… De même, invitant à se détourner des excès (« […] Dans quelque domaine que ce soit, l’excès est un vice » (2018 : 77)), le philosophe conseille d’éviter les relations passionnelles et les « personnes moroses », pour s’entourer d’amis fidèles.
Dans La retraite, le philosophe fait un lien entre les fréquentations choisies (1ère leçon) et la difficulté à suivre sa vision et les objectifs que l’on devrait s’être donnés (2ème leçon) :
« Nous deviendrons meilleurs en vivant isolés […] : nous ne sommes capables de persévérance dans nos choix que si personne n’est là pour ébranler, avec le concours de la foule, notre jugement encore fragile. […] Car de tous les maux, le pire est que nous sommes inconstants dans nos vices mêmes. […] Ce que nous avons recherché, nous l’abandonnons ; ce que nous avons abandonné, nous le recherchons à nouveau. Nous passons tour à tour du désir au regret. Entièrement suspendus au jugement des autres […]. » (2018 : 113-114)
Ainsi, bannissant l’inaction, la deuxième leçon viserait à concilier détachement et simplicité dans l’action. En s’engageant dans la vie publique ou en s’en retirant (« Il faut examiner si par nature tu es plus apte à l’action ou à l’étude et à la contemplation dans la retraite, et tendre là où te portera ton talent » (2018 : 68)), il ne faudrait ni s’isoler et se retirer du monde, ni s’adonner à des actions futiles : « Tout effort doit […] se rapporter à quelque chose, viser un but précis » (2018 : 91). Et toujours s’engager dans des actions vertueuses, aussi minimes soient-elles, en veillant à écarter l’ambition sans limite : « Le chemin suivi par la foule – celui de la gloire et des honneurs – est un piège qui se refermera sur celui qui l’emprunte » (commentaire de Juliette Dross en note de bas de page, 2018 : 114). Tout comme la richesse (4ème leçon), il faudrait se distancer de la gloire, de l’ostentation, de l’orgueil et de l’égo, car la discrétion et l’humilité, comme la simplicité, prémuniraient de la déconvenue : « Ce que nous prenons pour un sommet n’est en réalité que le bord d’un précipice » (2018 : 81). Ainsi, il vaudrait mieux « toujours mettre une limite à nos ambitions et […] leur fixer nous-mêmes un terme raisonnable, sans permettre à la Fortune de le faire » (2018 : 82).
Une troisième leçon, qui fait écho à une forme de retour au bercail, adouberait la mesure et le repos : « Retirons-nous en nous-mêmes, et ce fréquemment, car la fréquentation de gens trop divers rompt notre harmonie intérieure, réveille les passions et rouvre en notre âme toutes les blessures et les faiblesses qui n’étaient pas complètement guéries. Veillons cependant à mêler et à alterner ces deux attitudes, la solitude et la fréquentation du monde » (2018 : 106). Il faudrait ainsi veiller à se reposer, mais comme toujours, avec mesure, en évitant l’oisiveté ou le relâchement.
Dans une quatrième leçon, le philosophe encourage à une forme de détachement en regard des apparences, du superflu, du luxe et de la gloire, convaincu que « la richesse [est la] source principale des misères humaines » (2018 : 71).
« […] Songeons combien la douleur de ne pas posséder est plus légère que celle de perdre, et nous comprendrons que la pauvreté est d’autant moins sujette aux tourments qu’elle est à l’abri des risques ». (2018 : 71)
Cultiver un certain équilibre et une certaine tempérance, voire un dépouillement modéré, mais sans prôner le dénuement, serait la voie la plus sûr pour jouir d’une certaine sérénité : « En matière d’argent, le mieux est de ne pas tomber dans la pauvreté mais de ne pas trop s’en éloigner non plus » (2018 : 74) : « Habituons-nous à tenir le luxe à distance et à évaluer les choses non d’après leur faste, mais d’après leur utilité » (2018 : 75) ; « […] Contentons-nous déjà de réduire notre patrimoine, afin d’être moins exposés au revers de fortune » (2018 : 73-74). Cet équilibre est peut-être illustré par le conte du simple pêcheur, où argent accumulé, luxe et superflu sont tenus à distance pour préserver la sérénité.
Évitant les excès, Sénèque encourage à travailler « la richesse de nous-mêmes plutôt que la Fortune » (2018 : 76). Quant aux fréquentations (1ère leçon), il en va de même en regard de l’argent : « […] Tu trouveras plus de joie chez ceux que la Fortune n’a jamais regardés que chez ceux qu’elle a abandonnés » (2018 : 72).
La cinquième leçon relèverait de la première des Quatre nobles vérités et part du constat que la vie est souffrance et que tout est impermanent, ce qui induirait qu’il faut se préparer à l’adversité. Le sage en aurait conscience : pas plus la fortune que la santé (2018 : 85) ou la gloire, rien n’est permanant ; le sage serait donc prêt à rendre ce qui « lui a été prêté », sans jugement quant à ce qu’il doit endurer : « On vit mal si l’on ne sait bien mourir » (2018 : 84). Et Sénèque observe que l’adversité elle-même n’est pas permanente : « Face aux difficultés, fais appel à ta raison : ce qui était dur peut s’adoucir, ce qui était étroit s’élargir, et le fardeau peut devenir léger quand on sait le porter » (2018 : 80-81). Pour surmonter les épreuves, il faudrait donc s’y préparer :
« Ce qui peut arriver à l’un peut arriver à n’importe qui.
Si nous nous pénétrons de cette vérité et regardons tous les malheurs qui se battent quotidiennement sur autrui en nous disant qu’ils peuvent tout aussi librement s’abattre sur nous, nous serons armés bien à temps pour faire face à l’attaque ; en revanche, il est trop tard pour équiper notre âme contre les dangers au moment où ils nous assaillent. » (2018 : 86)
Il faudrait se préparer à accueillir les malheurs, car personne ne peut y échapper. En même temps, même dans les pires situations, « jamais […] la situation n’est obstruée au point de fermer tout espace à une action vertueuse » (2018 : 62), comme si la 6ème et dernière leçon devenait une forme d’antidote de résilience.
En guise de 6ème et dernière leçon, Sénèque résume assez simplement la raison d’être de l’existence humaine :
« […] L’unique devoir de l’homme : être utile aux hommes. » (2018 : 119)
Dans La retraite, le philosophe, pourtant stoïcien et donc inscrit dans l’action, privilégie la retraite, qui doit être considérée à la fois comme une retraite de la vie publique et une retraite plus spirituelle à l’intérieur de soi. Car, « quiconque s’améliore lui-même est utile aux autres par le fait même qu’il se rend capable de leur être utile à l’avenir » (2018 : 119).
Bien que décousus, ces deux textes présentent une recette à la sérénité, qui pourrait être résumée ainsi :
– en veillant à bien choisir ses amis ;
– en ne s’adonnant ni aux vices ni à l’oisiveté pour se tourner vers des actions visant le bien de l’autre et de son for intérieur ;
– en se préparant à l’adversité en prenant conscience de la futilité et de l’impermanence de l’argent, de la gloire et de la santé…
… « [on conserve ou on retrouve] la tranquillité » (2018 : 110).

0 commentaires