Socrate, Jésus, Bouddha
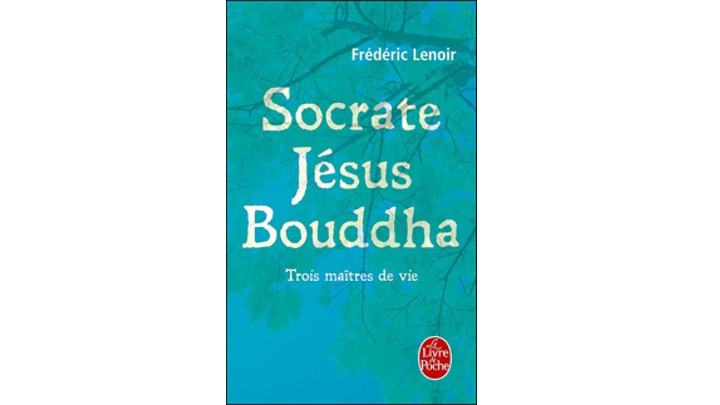
Références:
Lenoir, Frédéric
Socrate, Jésus, Bouddha : Trois maîtres de vie
Livre de Poche
2009
Résumé
Socrate, Jésus, Bouddha est un essai sur la crise de sens de la vie occidentale, où le progrès est défini comme l’obsession de posséder, toujours plus : « Qu’est-ce qui rend l’être humain heureux ? Qu’est-ce qui peut être considéré comme un progrès véritable ? Quelles sont les conditions d’une vie sociale harmonieuse ? » (2009 : 11).
Pour répondre à ces questions, Frédéric Lenoir met côte-à-côte trois maîtres à penser (ce qui caractérise tant Socrate, Jésus que le Bouddha, c’est « qu’ils ont mis leur enseignement en pratique », 2009 : 290), en comparant leur naissance, leur vie, leur mort et faisant se rencontrer leur pensée. Il entend par cette rencontre tracer les grandes lignes d’un humanisme spirituel, pour répondre aux défis d’une « planète par trop tiraillée entre une vision purement mercantile et matérialiste d’un côté, un fanatisme et un dogmatisme religieux de l’autre » (2009 : 16).
La première partie : leur vie respective
S’il n’existe pas de preuve indiscutable de l’existence de Socrate, Jésus et le Bouddha, cette dernière semble toutefois hautement probable (1er chapitre). D’origines sociales assez différentes et nés dans un environnement socio-politique et historique forts différents (2ème chapitre), rien ne semble les réunir. Par exemple, Socrate eut une épouse, des maîtresses, voire des amants, et des enfants, alors que Jésus ne sembla s’être jamais engagé, et que Siddhârta connaîtra des premières années bercées dans l’opulence, avant de renoncer à ces « faux bonheurs » et à pratiquer et à enseigner le renoncement (3ème chapitre). Ainsi, le désir sexuel sera, selon son enseignement, l’un des quatre principaux interdits, à côté de voler, de tuer et de mentir (2009 : 65).
Plus encore, ce qui semble esquisser certaines réelles divergences, en particulier entre Socrate d’un côté et le Bouddha et Jésus de l’autre, c’est leur personnalité (5ème chapitre). Alors que Socrate aurait été « un curieux mélange de maîtrise de soi et de violents accès de colère » (2009 : 89), dus à « ignorance et la stupidité [qui] semblent avoir le pouvoir de briser la carapace de Socrate et de lui faire perdre son sang-froid » (2009 : 91), le Bouddha fut « un individu doté d’une parfaite maîtrise de soi, serein en toutes circonstances, n’exprimant aucune préférence, aucun désir, aucun souhait, aucune aversion, aucun attachement, aucune émotion » (2009 : 92). En écho à l’apparente insensibilité du Bouddha (détachement face au caractère transitoire de toute chose), Jésus « apparaît bien au contraire comme pleinement humain avec sa sensibilité, ses luttes, ses émotions, ses sentiments » (2009 : 94).
Et pourtant, tous trois semblent avoir connu une forme d’appel de la sagesse (la « naissance d’une vocation », 4ème chapitre). Et là où fondamentalement ils se rencontrent, c’est dans la démarche réflexive qui les animent, une forme de quête de connaissance de soi. Tous trois cheminèrent dans la pensée, comme dans leur vie, caractérisée par la fuite des honneurs et de la richesse – de manière similaire, ils ne dénonçaient pas l’argent, mais l’amour de l’argent, éphémère). Tous trois prirent la route de manière quasi incessante : « Et c’est dans cette indépendance extrême, donc cette absence totale d’attaches, qu’ils ont puisé leur immense liberté » (2009 : 99). Ainsi, tous trois, par l’exemplarité de leur vie autant que par le « caractère profondément novateur de leur pensée en regard des opinions dominantes de leur époque et par la portée universelle de leur message » (2009 : 115), transmirent une pensée qui a traversé les siècles. Socrate était réputé pour son ironie et sa rhétorique fondée sur les questions posées à autrui, lui-même « ne sachant rien » ; le Bouddha, qui prônait l’ascèse et la méditation solitaire comme voies menant à la connaissance, tenait des sermons magistraux, dont le plus célèbre fut peut-être celui de Bénarès, où il exposa les Quatre Nobles Vérités du bouddhisme ; quant à Jésus, s’adaptant sans cesse à son auditoire et à son environnement, usa de tous les types de communication (dialogues, sermons, paraboles, prières…) pour tenir des discours teintés de radicalisme au regard de l’époque, dans le but explicite, tout comme le Bouddha, de finalement « sauver l’humanité ».
Vint enfin leur disparition : Socrate et Jésus furent condamnés et exécutés ; Bouddha mourut d’une intoxication alimentaire qui pourrait être de nature criminelle. Et tous trois auraient accepté la mort avec une grande sérénité, à l’instar de Socrate et Jésus, qui choisirent la mort plutôt que la fuite : « “L’important n’est pas de vivre, mais de vivre selon le bien” » (2009 : 155) :
La mort n’est pas une fin, mais un passage. Aussi bien pour le Bouddha que pour Socrate et Jésus, notre existence terrestre doit se comprendre dans une perspective plus large qui implique une vie après la mort. (2009 : 197)
La deuxième partie : leurs enseignements leur ont survécu
Tous trois se rencontrent ainsi autour de l’idée qu’il y aurait quelque chose après la mort. Pour le Bouddha, « la vie n’est qu’un cercle de souffrances qui commence à la naissance, ensuite ponctué par le “vieillissement, la maladie, la mort, le chagrin, la souillure” » (2009 : 198). Pour atteindre l’éveil et sortir de ce cercle, il recourut à trois notions : le karma (le mal que l’on ferait : « Pour le Bouddha, c’est l’intention de l’acte, et non l’acte lui-même, qui détermine sa valeur karmique », 2009 : 199-200) maintient le « Soi » dans le samsara (cycle de réincarnations et de souffrance de l’humain), l’empêchant d’accéder au nirvana (fin du cycle de réincarnations). Cette notion de réincarnation est illustrée par « l’exemple d’une bougie qui s’éteint et que l’on rallume. Il s’agit certes de la même bougie, de la même cire, de la même mèche, mais peut-on vraiment dire que le feu qui en jaillit est le même que celui qui a été soufflé ? » (2009 : 200). Certes avec certaines nuances, Socrate défendra pourtant une idée similaire de réincarnation, « chaque naissance étant conditionnée par celle qu’il l’a précédée, objectif de ce cycle étant une purification visant à accéder à des sphères supérieures » (2009 : 202). Enfin, même si Jésus parlera plutôt de vie éternelle, tous trois convergeront « sur le fait que nos actions présentes auront des conséquences dans une existence future » (2009 : 215).
Tous trois placèrent également la recherche de la vérité au cœur de leur enseignement : « Il est capital pour eux de discerner le vrai du faux, le bien du mal, le juste de l’injuste » (2009 : 217) :
- Faisant écho au « mythe de la caverne », la maïeutique socratique livrera une bataille contre le relativisme : « […] Considérer toute vérité comme relative revient à renoncer à ce qui constitue pour lui le but de la quête philosophique, à savoir précisément la recherche de la vérité » (2009 : 220-221).
- Le Bouddha fondera son enseignement sur les Quatre Nobles Vérités. Contrairement à Socrate, qui mettait en avant le raisonnement, le Bouddha privilégiera le travail d’introspection, via la méditation.
- Quant à Jésus, quittant définitivement le raisonnement, il incarnera la vérité ultime, à savoir que « Dieu est amour », à travers des aphorismes tels que « Ne juge pas » ou « Aime ton prochain comme toi-même ».
« La recherche de la vérité conduit à la vraie liberté : liberté de l’individu qui s’émancipe à l’égard de la tradition, de l’autorité ou des opinions dominantes de la société ; mais aussi et surtout liberté intérieure de l’être humain qui apprend, grâce à cette vérité, à se connaître et à se dominer » (2009 : 237) : liberté face au poids des traditions ou des Lois, liberté face à l’ignorance, liberté face au désir-attachement (soif), liberté face aux mauvais comportements… et « la gravité du péché n’est pas liée à la faute en soi, mais à l’intention qui y préside, et à son caractère plus ou moins volontaire » (2009 : 246). Chacun à sa manière, les trois maîtres inviteront à se connaître soi-même et à agir avec sagesse : « Pour Socrate, la vertu suprême est la justice. Pour le Bouddha, la compassion. Pour Jésus, l’amour » (2009 : 249).
Par justice, il faut entendre des notions comme l’équité et la vérité. Ces notions pointent du doigt une trop grande disparité des richesses, les inégalités liées à des origines sociales, ethniques ou encore de genre (homme/femme)…
Par amour, il ne faut comprendre ni le désir-éros, ni l’amitié-philia, mais l’amour universel (Agapè) : « La joie de donner gratuitement, sans rien attendre en retour, pas même un remerciement ou un signe de gratitude » (2009 : 276). On y retrouve l’adage « Aime ton prochain comme toi-même », écho à la parabole du bon samaritain. « Jésus montre que l’amour et la compassion sont au-dessus de la justice » (2009 :265) :
L’application de la justice doit se faire avec miséricorde, en tenant compte de chaque personne, de son histoire, du contexte, mais aussi de l’intention, de ce qui se passe dans l’intimité de l’âme, que nul ne peut sonder et encore moins condamner de l’extérieur. (2009 : 265)
Par compassion, le Bouddha entendit enfin dépasser l’amour-désir (désir-éros), le désir-soif causant la souffrance, tout comme l’amitié-philia. Mais alors, « l’indifférence envers autrui est-elle de mise pour ne jamais souffrir ? L’impassibilité serait-elle alors la vertu suprême ? » (2009 : 282). Si le bouddhisme considère le Soi comme une illusion, il est néanmoins invité à aimer l’autre et être sensible à sa souffrance. Si les deux principaux courants bouddhistes (Theravada vs Mahayana) diffèrent quant à la réponse à apporter à la question de l’indifférence envers autrui, pour la majorité (Mahayana), la compassion est devenue la vertu cardinale du bouddhisme : « […] Le respect envers tout être vivant doit se comprendre dans un sens beaucoup plus actif et élargi : celui d’une compassion active et universelle » (2009 : 282), dépassant même l’horizon anthropocentrique de Socrate et Jésus, pour s’étendre au respect de la nature et des animaux :
On le sait compassionnel, bienveillant, mais ses gestes de compassion n’interviennent pas en réaction à un sentiment ou une émotion. Le Bouddha s’observe en pleine conscience et insiste sur le caractère transitoire de toute chose, ce qui explique certainement son détachement vis-à-vis de toute chose. (2009 : 93)

0 commentaires