L’enseignement du Bouddha
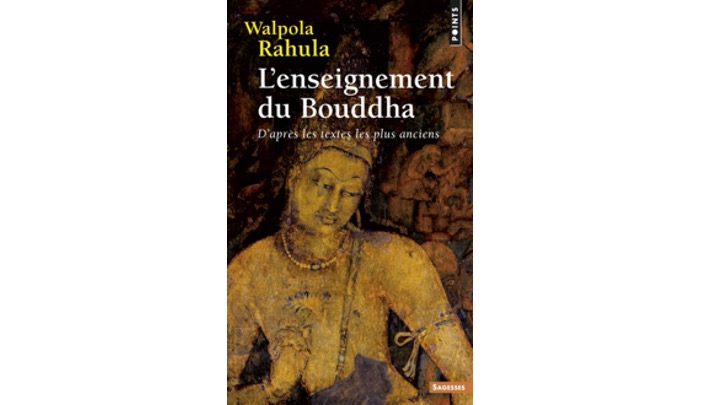
Références:
Rahula, Walpola
L’enseignement du Bouddha
Points
1961
Résumé
Cet ouvrage présente les principaux enseignements du bouddhisme au travers du regard expert et pratiquant d’un bouddhiste : « J’ai traité dans ce livre de presque tout ce qui est communément accepté comme constituant l’enseignement essentiel du Bouddha. Ce sont les doctrines des Quatre Nobles Vérités, du Noble Sentier Octuple, des Cinq Agrégats, du Karma, de la Renaissance, de la Production conditionnée […], la doctrine du “Non-Soi” […] et celle [de] l’Établissement de l’Attention » (1961 : 10).
L’auteur commence par rappeler que contrairement aux traditions religieuses usuelles, le bouddhisme ne promeut aucune vénération à un dieu quelconque : l’être humain serait son propre maître, déterminé par sa volonté et par sa responsabilité individuelle, décidant par lui-même de ce qui serait bon ou mauvais pour lui, selon le précepte du Karma (1961 : 52-55). Son corolaire serait d’opérer une sérieuse introspection avant de « faire la leçon » aux autres : « Commence par t’établir toi-même dans le droit chemin, puis tu pourras conseiller les autres. Que l’homme sage ne donne aucune occasion de reproches » (Paroles de vérité, cité par Rahula 1961 : 175) :
« Facile à découvrir est la faute d’autrui, mais notre faute est difficile à percevoir. » (Paroles de vérité, cité par Rahula 1961 : 178)
Cette forme de liberté et de tolérance doit cependant être assortie de la connaissance, car « les racines de tout mal sont l’ignorance et les vues fausses » (1961 : 19) :
« Presque toutes les religions sont basées sur la foi – une foi plutôt “aveugle”, semble-t-il. Mais dans le bouddhisme, l’accent est mis sur “voir”, savoir, comprendre, et non pas sur foi ou croyance.
[…] Le Bouddha a ouvert les yeux des gens et les a invités à voir librement ; il ne leur a pas bandé les yeux en leur commandant de croire. » (1961 : 25-27)
Au travers d’une parabole comparant l’enseignement du Bouddha à un radeau, Walpola Rahula cite le Bouddha, qui aurait dit : « Être attaché à une chose (un point de vue) et mépriser d’autres choses (d’autres points de vue) comme inférieures, cela les sages l’appellent un lien » (Suttanipáta (édition PTS), p. 151, v. 789, cité par Rahula 1961 : 29). En d’autres termes, le Bouddha inviterait à ne pas s’attacher à ses propres enseignements, mais à toujours prendre de la distance, du recul, en regard de toute forme d’enseignement.
Si Rahula pointe le caractère non dogmatique des enseignements du bouddhisme, il souligne aussi l’inanité de certains discours. Ainsi, si la principale cause de souffrance est l’ignorance (deuxième noble vérité) et si, parmi les remèdes de l’octuple sentier, la compréhension et la pensée justes (la sagesse) font partie des huit principes de vie, le Bouddha aurait aussi dénoncé les « déserts d’opinions », à savoir « la discussion de questions métaphysiques inutiles » (1961 : 31). Il aurait critiqué toutes les questions dont finalement la réponse n’a pas d’importance pour réduire la souffrance, prenant l’exemple d’un homme blessé par une flèche : y a-t-il besoin de connaître le type de flèche, d’arc, etc., pour soigner cet homme blessé ? Et lui-même, a-t-il besoin de connaître le type de flèche, d’arc, etc., pour être soigné ? : « Quelle que soit l’opinion qu’on puisse avoir sur ces problèmes, il y a la naissance, la vieillesse, la décrépitude, la mort, le malheur, les lamentations, la douleur, la peine, la détresse, “dont je déclare la cessation [c’est-à-dire le Nirvana] dans cette vie même” » (1961 : 33).
C’est sur ces fondements (non-dogmatisme ; pensées utiles) que Walpola Rahula présente les quatre nobles vérités, dont il fait la présente synthèse :
« Nous avons quatre fonctions à exécuter à l’égard des Quatre Nobles Vérités :
La Première Noble Vérité est dukkha, la nature de la vie, sa souffrance, ses chagrins et ses joies, son imperfection et son insatisfaction, son impermanence et son insubstantialité. À cet égard, notre fonction est de comprendre cela comme un fait, clairement et complètement […].
La Deuxième Noble Vérité est l’origine de la dukkha, qui est désir, “soif”, accompagné de toutes les autres passions, souillures et impuretés. La simple compréhension de ce fait n’est pas suffisante. Ici notre fonction est d’écarter ce désir, de l’éliminer, le détruire et le déraciner […].
La Troisième Noble Vérité est la Cessation de la dukkha, le Nirvana, la Vérité absolue, la Réalité ultime. Ici notre fonction est de l’atteindre, la comprendre […].
La Quatrième Noble Vérité est la Sentier conduisant à la compréhension du Nirvana. La simple connaissance du Sentier, quelle que complète qu’elle soit, ne suffit pas. Dans ce cas, notre fonction est de la suivre et de nous y tenir […]. » (1961 : 74)
Il développe alors le sujet de la méditation et de ses corolaires (pleine conscience, respiration…), qui sont présentés dans le bouddhisme comme les principaux outils de l’octuple sentier.
Walpola Rahula conclut son ouvrage, avant de présenter un choix de textes bouddhistes, par une réflexion autour de la mise en pratique du bouddhisme. Il souligne en particulier, en conformité avec la voie du milieu, que « la croyance courante, selon laquelle il faudrait fuir la vie pour suivre l’enseignement du Bouddha, est fausse » (1961 : 106) :
« […] Il est certainement plus louable, et cela demande plus de courage, de pratiquer le bouddhisme en vivant au milieu de ses semblables, les aidant et leur rendant service. Il peut être utile, dans certains cas, qu’un homme vive pour un temps dans une retraite, afin de perfectionner son esprit et son caractère, comme exercice moral et spirituel préliminaire, afin de devenir assez fort pour en sortir ensuite et rendre service aux autres. [Mais] l’esprit de l’enseignement du Bouddha […] a pour fondement l’amour, la compassion et le service des autres. » (1961 : 107)
Évoquant la vie des moines et des laïcs, observant que « si on comprend l’enseignement du Bouddha, si on a la conviction que cet enseignement est la voix juste et si on s’efforce de le suivre, alors on est un bouddhiste » (1961 : 111), il porte un regard critique sur les manifestations ostentatoires du bouddhisme, qui devrait d’abord se vivre de l’intérieur : «La tête rasée ne fait pas un ascète de l’homme qui reste indiscipliné et menteur » (1961 : 178). À titre d’exemple, il présente les cinq préceptes minimaux d’un bouddhiste laïc, « c’est-à-dire 1. ne pas détruire la vie, 2. ne pas voler, 3. ne pas commettre d’adultère, 4. ne pas mentir, et 5. s’abstenir de boissons enivrantes » (1961 : 111). Les huit préceptes (à appliquer lors des nuits de pleine lune et nouvelle lune) complètent cette liste par « 6. ne pas prendre de nourriture solide après midi, 7. ne pas utiliser de sièges et lits luxueux est confortables, et 8. ne pas danser, chanter, s’amuser, ne pas user de guirlandes et de parfums » (1961 : 112). Le tout devrait être compris non pas comme un renoncement à la joie, mais comme un encouragement à suivre la voie du milieu : boire modérément de l’alcool, jeûner régulièrement, dormir de temps en temps sur une couche moins confortable (par exemple en camping), privilégier une vie équilibrée (se coucher tôt et se lever tôt, de manière régulière, en lieu et place de longues soirées devant la télévision…).
L’auteur conclut son ouvrage en revenant sur les valeurs fondamentales qui traversent le bouddhisme, et en particulier celle de la non-violence : « Jamais par la haine la haine n’est apaisée ; mais elle est apaisée par la bienveillance » (1961 : 119) :
« On devrait vaincre la colère par la bienveillance, la méchanceté par la bonté, l’égoïsme par la charité et le mensonge par la véracité. » (1961 : 119)

0 commentaires