Le réveil
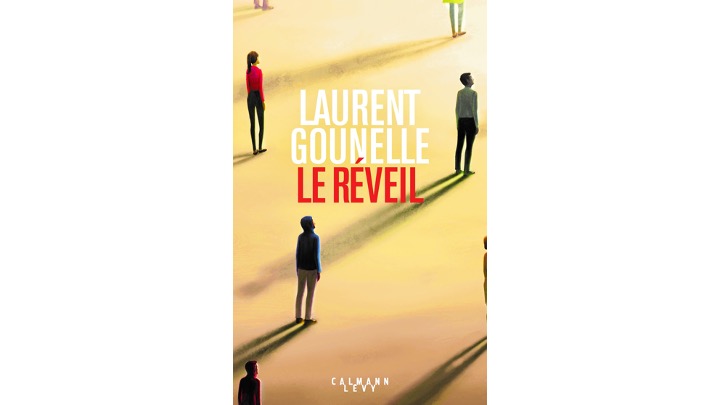
Références:
Gounelle, Laurent
Le réveil
Calmann-Levy
2022
Résumé
Disons-le promptement, l’intrigue de ce roman est inexistante. Laurent Gounelle nous livre deux soliloques : Tom, jeune parisien vivant en périphérie (France : berceau de la liberté), et Christos, jeune grec vivant à Athènes (berceau de la démocratie), le tout parsemé de quelques anecdotiques échanges téléphoniques entre les deux protagonistes.
Ce « roman » est en revanche un plaidoyer décapant pour la vie et contre « la guerre à la mort ». Il part du principe que l’un des travers de l’humain est de refouler sa finitude (première des 4 nobles vérités du bouddhisme). Or, le principe du « zéro risque » visé par la « guerre à la mort » « ne revient-il pas à sacrifier la vie » (2022 : 21) ? Il met alors en exergue, en les décortiquant, les leviers et les dérives manipulateurs qui se sont exprimés (durant la pandémie Covid-19), ou plutôt exacerbés, car lancinants depuis plus d’un siècle.
Tom, la grenouille piégée dans un apparent confort
Tom incarne l’homme ordinaire, victime léthargique des techniques manipulatrices, et qui, comme une grenouille dans une casserole d’eau tiède, se trouve peu à peu piégé, à la manière du roman métaphorique Matin brun. Par exemple, face à l’interdiction progressive de la consommation de sucre, il ne réagit pas, car peu concerné : « De toute façon, ça m’était égal : à part ma petite faiblesse pour le chocolat, j’étais plus bec salé. Bref, je n’étais guère concerné » (2022 : 126).
Sans évoquer explicitement le Covid-19, Laurent Gounelle illustre ses propos par une série de « guerres contre la mort » à la fois actuels et métaphoriques en regard de la pandémie :
I. La lutte contre les morts sur la route (2022 : 18), par le remplacement des voitures traditionnelles par des voitures à conduite autonome ;
II. La lutte contre le sucre (2022 : 77), visant à réduire des maladies telles que le diabète ou les maladies cardio-vasculaires, par « l’implantation d’un capteur biométrique » (2022 : 79) permettant de suivre en temps réel, via son smartphone, les données métaboliques du corps ;
III. La lutte contre la criminalité (2022 : 119) par la suppression du paiement en espèces dont se serviraient les criminels (l’argent n’a pas d’odeur), privilégiant les cartes de débit et de crédit ;
IV. La lutte contre le réchauffement climatique (2022 : 142) par un contrôle drastique et impitoyable de la consommation énergétique des ménages (chauffage, déplacement en voiture…) ;
V. La lutte contre l’insécurité (2002 : 151) par la systématisation des caméras à reconnaissance faciale, visant à prévenir et réduire la violence et la criminalité que la mesure III n’était pas parvenue à entraver.
La métaphore filée avec la pandémie de Covid-19 s’immisce insidieusement au travers de multiples mesures parfois aussi caricaturales que la gestion de la pandémie a pu l’être :
– Les minerves (= masques) deviennent obligatoires, à cause de ceux qui ne veulent pas passer à la voiture autonome (= vaccin) ;
– Ceux qui refusent de s’implanter un capteur biométrique (= vaccin) se voient refuser l’accès à certaines prestations (= soins intensifs) et certains magasins, n’ayant pas le passeport nécessaire (= pass sanitaire) ;
– Ceux qui refusent de s’implanter un capteur biométrique (= vaccin) sont menacés d’un supplément de cotisation sociale.
Christos, complotiste ou messie
Christos incarne quant à lui soit le « complotiste », celui qui résiste en brandissant la théorie du complot mondial, soit le gardien du temple, le Neo révélant la matrice des multinationales et les méfaits de la mondialisation (2022 : 74-75). Christos, se référant au trilemme de Rodrik (2022 : 81-86), souligne l’antagonisme dans lequel les sociétés modernes naviguent…, car il serait « impossible pour une nation d’être en même temps souveraine, mondialisée, et démocratique » (2022 : 83).
Se référant aux travaux de Noam Chomsky, Christos met en exergue la manipulation opérée à travers les médias de masse (et plus récemment les réseaux sociaux), qui diffusent une représentation caricaturale du monde : « En lisant le journal, vous avez des nouvelles de ce qui est écrit dans le journal » (2022 : 26). Il évoque par exemple les travaux d’Edward Bernays, tournés explicitement vers la manipulation des masses, et cite à nouveau Noam Chomsky : « “La manipulation est aux démocraties ce que la matraque est aux régimes totalitaires” » (2022 : 94).
Pour tenter de « réveiller » son ami avant qu’il ne soit trop tard, il s’engage dans la rédaction d’un « petit inventaire » classifiant les principaux ressorts manipulateurs qui se sont progressivement mis en place, affinés à travers un siècle d’expérimentations. Il commence par présenter les techniques de coercition développées en Chine en vue de leurs interrogatoires de soldats américains (guerre de Corée), tirées de la « charte de Bidermann » (2022 : 109ss.) :
1. Isolement : confiner, coupant ainsi la personne de tout contact social. « Toute l’histoire du contrôle sur le peuple se résume à cela : isoler les gens les uns des autres, parce que si on peut les maintenir isolés assez longtemps, on peut leur faire croire n’importe quoi » (Chomsky, Noam 2008 : Comprendre le pouvoir, cité par Gounelle 2022 : 111).
2. Monopolisation de la perception : occuper l’esprit par un élément unique et si possible anxiogène. Ce principe est notamment illustré par l’exacerbation médiatique de sujets anxiogènes : « Les médias se mirent à annoncer chaque jour le nombre de morts de la veille » (2022 : 19).
3. Induction de débilisation : affaiblir les capacités mentales et physiques, par exemple par la privation de sommeil ou par l’obligation de réaliser des activités qui ne font pas sens.
4. Menaces : créer un environnement anxiogène par des menaces sourdes.
5. Indulgences occasionnelles : récompenser l’obéissance ou empêcher de s’adapter à la privation.
6. Démonstration de puissance : faire montre d’une toute puissance sur la personne.
7. Humiliation : humilier toute tentative de résistance, présentée comme vaine.
8. Faire respecter des exigences dénuées de sens : fixer des règles sans fondement.
Ayant rappelé ces huit premières techniques, Christos complète son petit traité des principaux ressorts de manipulation par huit autres techniques (2022 : 130ss.) :
9. Émettre des injonctions paradoxales : « Promettre la liberté à ceux qui se soumettront » (2022 : 130).
10. Caricaturer la position des résistants : disqualifier l’avis des opposants.
11. Instaurer des clivages : par exemple, rendre responsables les opposants des maux que doivent subir les soumis.
12. Infantiliser les gens : rendre les gens dépendant pour leur survie (vs autonomie) : « Le revenu universel était typique de ces aides devenues nécessaires pour compenser les effets délétères de la mondialisation, et qui en même temps rendent les citoyens dépendants de l’État et du bon vouloir de ses dirigeants » (2022 : 138).
13. Conjuguer flatterie et culpabilité : rendre les gens responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent.
14. Étiqueter les résistants : par exemple en collant l’étiquette de « complotiste » à toute personne résistante.
15. Pratiquer la gradualité : stratégie manipulatrice du pied dans la porte, à savoir obtenir quelque chose étape par étape.
16. Obscurcir les repères informationnels : par la censure en particulier : « La liberté d’expression n’a de sens que si elle s’applique aux opinions qui vous répugnent » (Chomsky, cité par Gounelle 2022 : 161).
L’auteur va plus loin, en suggérant que ces ressorts manipulateurs sont utilisés à l’international, par des multinationales et des banques d’affaire (lire Roche, Marc 2011 : La Banque. Comment Goldman Sachs dirige le monde, Points) plus puissantes que les états eux-mêmes. Car comment expliquer que tous les pays, de la Chine aux Etats-Unis en passant par l’Europe, ont adopté des règles assez similaires pour endiguer la pandémie. Les positions de l’auteur souffriraient naturellement de contre-arguments ; mais nonobstant ces derniers, l’ouvrage met en perspective (et en garde) les risques auxquelles les sociétés souveraines, mondialisées et démocratiques (trilemme de Rodrik) sont confrontées.
Laurent Gounelle conclut son roman par quelques mots d’excuse, ceux d’avoir trahi le lecteur par un « roman » qui n’en serait pas un, et qui ressemble plus à un pamphlet accusateur. Il s’en dédouane par sa volonté de mettre en lumière les ressorts manipulateurs qui divisent et clivent la société. Ainsi, Tom, les personnages de Matin brun et nous-mêmes ne sommes-nous pas autant de grenouilles dans une casserole d’eau tiède ? Alors, comme le disait cheikh el-raïs, « Moi, ce qui m’intéresse, ce n’est pas la longueur de la vie. C’est sa largeur » (2022 : 169).

0 commentaires