La part du colibri
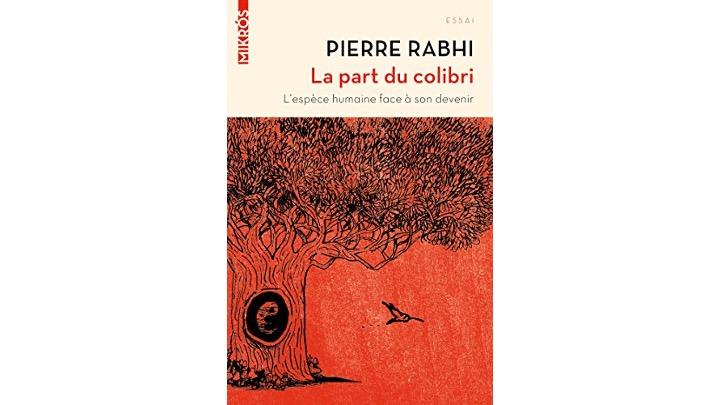
Références:
Rabhi, Pierre
La part du colibri : l’espèce humaine face à son devenir
De l’Aube
2018
Résumé
Avec la plume poétique et la verve militante qui le caractérisent, Pierre Rabhi a popularisé la légende amérindienne du colibri, en la présentant comme l’antidote au traitement inconscient que l’humain ferait à la Terre, et notamment au monde animal, « ravalé dans notre société d’hyperconsommation à des masses ou à des fabriques de protéines » (2018 : 8).
Pour l’auteur, un profond changement de conscience est indispensable, qui touche à la question des intelligences : « […] Je me demande si nous ne confondons pas nos aptitudes, qui nous permettent tant de performances pour le meilleur et pour le pire, avec l’intelligence qui devrait éclairer nos actes et nous aider à construire un monde différent » (2018 : 9). L’« inconscience » actuelle, basée sur l’intelligence logico-mathématique, élèverait au panthéon une économie « stimulée par l’avidité et l’insatiabilité humaine érigées en système économique » (2018 : 15). Avec, en toile de fond, ce qu’il présente comme une forme d’amnésie, et qui pourrait être reformulée comme un refoulement débonnaire, un syndrome de l’autruche : « Nous passons notre temps à oublier, oublier que nous vivons sur une planète limitée à laquelle nous appliquons un principe illimité, ce qui accélère le processus d’épuisement des ressources et d’accroissement des inégalités structurelles, source de mécontentements, de frustrations et de conflits » (2018 : 14).
Fin observateur du monde occidental, l’auteur constate :
-
-
- La domination du modèle pyramidal, auquel on pourrait opposer les modèles opales ;
- Une forme d’enfermement dans une logique et un monde qui se présentent pourtant comme libérateurs : « […] le hublot de la télévision, qui permet un lien avec le vaste monde, fait oublier le confinement des habitants » (2018 : 30) ;
- « La cité urbaine [qui] a pris la configuration de l’enclave minérale qui ne cesse de miter l’espace naturel par son extension. […] La ville engloutit des masses considérables de matière vitale sans contribuer à la produire » (2018 : 29) ;
- Une empreinte écologique insupportable par la planète, elle-même transformée en « désert de maïs, de blé et de tournesol » (2018 : 31), pour nourrir des bœufs dont le ratio calorique est dix fois inférieur pour une consommation d’eau considérable ;
- Une « insalubrité » de la nourriture qui serait à l’origine d’une grande partie des maladies modernes ;
- Une idéologie technico-scientifico-marchande « qui a donné à l’argent une prépondérance et un pouvoir absolu sur le monde » (2018 : 21) ;
- La publicité et le marketing, dont le rôle serait d’exacerber l’insatisfaction, observant que le superflu n’a pas de limite, contrairement aux vrais besoins qui eux, auraient une limite naturelle.
-
Pour l’un des précurseurs de l’agroécologie, l’éveil des consciences, un « sursaut de conscience » (2018 : 38), basé sur des intelligences interpersonnelle, naturaliste et existentielle, serait la seule voie au salut. Elle pourrait passer par :
-
-
- Une féminisation de la société ;
- L’éducation des enfants, en particulier pour les reconnecter à la nature ;
- Une relocalisation de l’agriculture et de l’artisanat qui peuvent l’être, avec des circuits plus courts ;
- Une production plus rationnelle, durable et modérée, et « non cette pléthore générant des rebus monstrueux dans la production massive est significative de l’inintelligence du système – ou peut-être de son cynisme » (2018 : 25).
-
À titre d’exemple, l’auteur signale un accident caricatural : « Dans les années 1980, on a pu voir un camion bourré de tomates quittant l’Espagne pour livrer la Hollande ; dans le même temps, un camion bourré de tomates partait de la Hollande pour livrer l’Espagne. Des circonstances incroyables ont fait qu’ils se sont percutés dans la vallée du Rhône, mêlant pêle-mêle des tomates hollando-espagnoles ! » (2018 : 24).
Mais ce changement de conscience ne pourrait pas rester superficiel ; il nécessiterait au contraire une véritable révolution des valeurs qui sous-tendent la société :
[…] Si l’être humain ne change pas quotidiennement pour atteindre générosité, compassion, éthique et équité, la société ne pourra changer durablement. On peut manger bio, recycler ses déchets et ses eaux usées, se chauffer à l’énergie solaire et exploiter son prochain » (2018 : 26).
Critique à l’égard des grandes messes allant de Rio (1992) à Glasgow (2021), en passant par Kyoto (1997), Copenhague (2009) ou encore Paris (2015), qui semblent sourdes aux rapports pourtant alarmants émanant notamment du GIEC (Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat), Pierre Rabhi invite, au travers de sa légende amérindienne du colibri, à incarner individuellement ce changement :
« Dans un échange avec mon ami Yehudi Menuhin, je lui disais qu’il n’est jamais trop tard pour agir. Il m’a rappelé très judicieusement qu’il est toujours trop tard pour quelqu’un. Pessimisme ou optimisme n’a pas de signification pour moi » (2018 : 38).
Ces propos conclusifs inviteraient ainsi à sortir la tête du sable, à se responsabiliser individuellement et à agir à sa hauteur, sans attendre que quelqu’un le fasse à notre place.

0 commentaires