Comment rester serein quand tout s’effondre
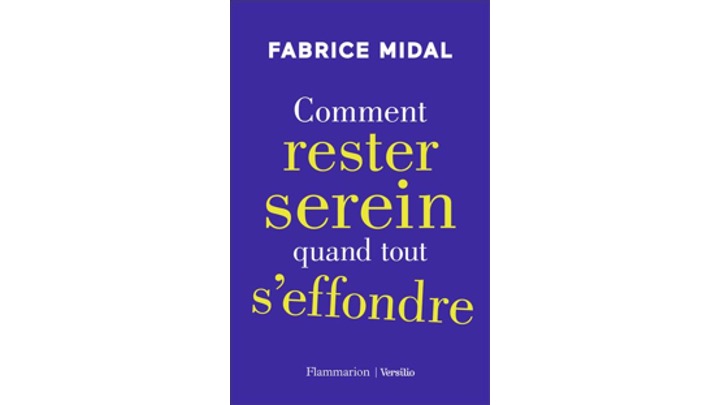
Références:
Midal, Fabrice
Comment rester serein quand tout s’effondre
Flammarion
2020
Résumé
Par cet ouvrage sur la résilience, l’auteur vise à accompagner tout un chacun à surpasser ses difficultés majeures, car « même si je me sens très seul, je ne suis pas le seul à traverser des difficultés : la maladie, le chômage, les séparations, les crises sociales, économiques, écologiques, sanitaires, personnelles sont notre lot commun. Inutile de nous leurrer : c’est la loi de l’existence » (2020 : 11).
Risquons en introduction une remarque, de laquelle découlera le présent résumé. Les 15 chapitres ne semblent pas offrir une organisation claire, un fil conducteur, mais présentent plutôt des répétitions et des redondances peu ordonnées. Face à ce dédale peut-être volontaire (la répétition a ses vertus…), sept grands principes ont été identifiés.
1. Accepter l’impermanence
Sans faire référence à la première des quatre nobles vérités du bouddhisme, l’auteur rappelle toutefois à plusieurs reprise l’évidence de l’impermanence du monde (et que, selon le 3ème principe identifié, le changement engendrerait de la souffrance) : « Il est une vérité qu’il est bon de reconnaître, d’admettre : un monde immuable n’existe pas. […] La vie est mouvement et c’est en cela qu’elle est précieuse » (2020 : 24).
Or, deux résistances pourraient accroître la souffrance engendrée par le changement. D’une part, l’enfermement dans la douleur, parfois doublé de culpabilisation (5ème principe). D’autre part, le déni du réel : « Mon patron vient de me signifier mon licenciement, je ne fais rien, j’espère qu’il va changer d’avis ; ma compagne m’a quitté, je l’attends, j’espère qu’elle va revenir ; et j’espère aussi que je vais gagner au loto pour régler tous mes soucis financiers et partir en week-end sous les tropiques » (2020 : 92).
Au contraire, face à la souffrance engendrée par le changement, il faudrait la reconnaître, y mettre des mots, l’embrasser même.
2. Regarder la réalité en face
L’auteur, évoquant le Livre de Job, semble critiquer le détachement : « Par cette injonction, il fait fi de la morale du détachement, de la fausse sérénité qui, en nous interdisant de laisser déborder notre cœur, nous transforme en objets. “Jamais il n’y eut philosophe qui patiemment put endurer le mal de dents”, notait Shakespeare » (2020 : 45-46).
Mais c’est que l’auteur est dans un chapitre consacré à l’écoute, à sa propre écoute. Celle de ne pas refouler, mais de ressentir, de s’écouter… La première étape serait donc de reconnaître cette souffrance (« Je suis triste » ; « Je suis anxieux » ; « Je suis blessé »…) et d’observer ce qu’elle provoque en soi : « Nous savons que nous pouvons toujours essayer de nous leurrer, de ne pas voir la réalité pour rester gais. Mais nous savons aussi que nous ne pouvons pas mentir longtemps » (2020 : 24).
Mettre des mots sur ses sentiments (haine, tristesse, peur…) permettrait de les affronter, de les dépasser : « Je ne connais pas d’autres moyens de ne pas me laisser déborder par la douleur, de ne pas m’engluer éternellement dans la rumination » (2020 : 46).
Fabrice Midal conteste en cela la pensée stoïcienne, qu’il résume en ces termes : « La sérénité, le bonheur ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de ma seule volonté de m’en détacher » (2020 : 72). L’auteur critique un peu vite Épictète (Cornette de Saint Cyr 2017) et les stoïciens, dont le fondement n’est pas le détachement absolu et l’abdication de tout sentiment humain, mais la distinction entre d’un côté ce sur quoi on peut agir et, de l’autre, ce qui ne dépend pas de soi et qui nous échappe. Ils prônent certes le non-attachement et le non-jugement, mais toujours inscrits dans le monde et dans l’action (4ème principe).
3. Considérer les crises comme des opportunités
Fabrice Midal se réfère à l’étymologie chinoise du terme de « crise » pour insister sur les potentialités que recèle une crise : le terme chinois Wei-ji : « Wei signifie le problème, la difficulté […]. Ji, qui lui est soudé, et la chance, l’opportunité, le dynamisme » (2020 : 30). La crise serait donc la tension entre un avant et un après, un entre-deux.
Le « monde immuable » est présenté comme un « paradigme statique », une zone de confort étiquetée comme étant positive, souhaitable. Évoquant le conte de Hansel et Gretel, Fabrice Midal présente la maison de la sorcière comme « une jolie métaphore de la niaiserie du bien-être et de la facilité auxquels nous conditionne la société, mais qui nous empoisonnent et finissent par nous détruire » (2020 : 85). A contrario, le changement et la crise (« paradigme du mouvement ») provoqueraient la perte de repères, la peur et la souffrance, tagués de négatifs.
Pourtant, en dépit de l’inconfort plus ou moins intense qu’il provoque, le changement « nous permet de trouver une solution, de nous réinventer, d’être créatifs, de fuir au besoin, d’agir à partir des difficultés rencontrées » (2020 : 21). Le changement deviendrait ainsi l’occasion de s’interroger sur ses réelles priorités (ikigai), de se recentrer sur ses objectifs, de se déconstruire pour se réinventer.
Plus encore, à force de vivre dans un mode aseptisé, sans risques, on se priverait de développer sa résilience : « Refuser les épreuves, les mauvaises surprises, le négatif, ce n’est plus pouvoir grandir, exulter, tomber, me relever, découvrir mes forces et apprendre la confiance en moi, avancer » (2020 : 81). Alors même qu’« il est merveilleux de vaincre les résistances, de surmonter les obstacles : c’est ce qui rend le plus heureux ! » (2020 : 83) :
« La vraie joie ne vient que dans la victoire sur nos croyances, sur nos peurs, sur nos a priori, sur ce négatif qui nous terrorise et contre lequel nous aspirons à nous prémunir de toutes les façons possibles. C’est oublier que sans lui, nous sommes privés de nos capacités. » (2020 : 83)
Le confort, la routine et la sécurité sont confortables. La voie du milieu en préconiserait cependant un dosage raisonnable, car s’ils permettent de se ressourcer, ils risquent tout autant d’étouffer la vie : « Une vie heureuse se situe entre l’ordre et le chaos, dans une alternance, dans le jeu toujours à reprendre entre le fait de prévoir et celui de savoir qu’on ne peut pas tout prévoir » (2020 : 107). Car finalement, la crise est peut-être l’occasion de retrouver sa liberté, de « redevenir vivant » (2020 : 141).
4. Passer rapidement à l’action
Fabrice Midal se réfère à l’étymologie grecque du terme de « crise » pour insister sur l’importance de l’action. Le terme grec krinein « signifie séparer et trier afin de choisir et décider » (2020 : 35), invitant ainsi à rapidement passer à l’action. Il évoque à ce propos l’histoire du homard pour encourager à l’action et non pas :
– se conforter dans le déni, « se morfondre dans sa carapace devenue trop étroite » (2020 : 32),
– s’enfermer dans un statut de victime (5ème principe),
– « adopter la position du pseudo-sage qui contemple la situation avec distanciation » (2020 : 121),
– ou encore obéir à sa peur : « […] l’écouter mais ne pas lui obéir » (2020 : 52).
Il s’agirait donc de « dépasser le plus rapidement possible la phase d’attentisme et d’immobilisme car elle conduit à un échec inéluctable » (2020 : 32). Et si « le premier pas nous semble le plus difficile » (2020 : 32), il serait essentiel car il permettrait de déclencher les suivants. David Allen, dans S’organiser pour réussir, considère tout problème comme un projet : « Quand vous identifiez un problème et non une chose qu’il faut bien accepter telle qu’elle est, vous sous-entendez qu’il existe une solution potentielle » (Allen 2015 : chapitre 7). L’action devient alors un outil de résilience : lorsqu’un problème, une tension, une question, un souci… arrive, le faire passer dans la moulinette GTD en fait ressortir « naturellement » une action suivante ; ainsi, cela libère fantastiquement l’esprit (chapitre 15).
Ce passage à l’action rappelle aussi les personnages de Qui a piqué mon fromage ? : Flair et Flèche partent à l’action et alors que Pelochon et Baluchon s’enlisent dans la réflexion (par prudence, pour trouver toutes les réponses avant de passer à l’action), voire dans la résistance (se considérer comme victime de la situation).
« Mais attention : l’action dont je parle n’est pas la gesticulation, elle n’est pas non plus l’activisme » (2020 : 124). Il s’agirait donc de prendre du recul, de réfléchir, mais « c’est une erreur quand la réflexion devient enlisement, ressassement, paralysie » (2020 : 124). Il ne faudrait donc pas attendre toutes les réponses, toutes les certitudes, pour engager le premier pas.
5. Éviter la culpabilité
« Chercher des coupables ne permet pas de trouver la solution » (2020 : 39). Le double paradigme de la culpabilité (soit l’auto-culpabilité, soit s’enfermer dans le statut de victime de la culpabilité d’autrui) mènerait à un sentiment d’injustice : « Peut-être est-il temps d’admettre que dans l’épreuve de la souffrance, dans l’épreuve de la crise, dans l’épreuve de la difficulté, il n’y a pas de raisons, il n’y a pas d’explications à tout » (2020 : 44).
En lieu et place de se demander « pourquoi y a-t-il de telles injustices dans le monde ? » (2020 : 44), il s’agirait donc de se demander comment en sortir. Plutôt que de chercher un sens au problème, il faudrait rechercher la solution pour en sortir.
L’auteur nuance judicieusement ses propos en n’écartant pas définitivement une part de responsabilité : « Ne pas se sentir coupable n’est pas nier toute responsabilité : bien sûr dans certains cas, nous aurions pu mieux prévoir, peut-être aurions-nous dû nous défendre autrement, ne pas fermer les yeux sur les prémices de la crise » (2020 : 44-45). Mais la part de responsabilité est toujours partielle : en tirer des enseignements, oui ; s’accabler, non.
Cela consisterait enfin à accepter ses émotions (2ème principe), sans y rajouter le poids de la culpabilité (2020 : 74).
6. Développer une pensée positive
SI le déni (1er principe), qui est « une justification du renoncement » (2020 : 92), serait à éviter, cultiver l’espoir serait en revanche un pari sur l’avenir : « L’espoir qui me portera va nourrir mon allant, mon enthousiasme. Il va me donner envie de m’engager, de donner le meilleur de moi-même. Il sera l’antidote au découragement » (2020 : 94). Ainsi, si des moments de désespoir peuvent survenir, le pari sur l’avenir pourra servir d’étincelle, de combustible à l’imprévu :
« J’espère parce que je ne me laisse pas engluer dans les bavardages et les petites projections qui ferment le possible. J’espère parce que je suis humble. Comme le disait Kant, prétendre savoir de quoi sera fait l’avenir relève d’une erreur de la raison, l’être humain étant incapable d’avoir un rapport objectif au réel. » (2020 : 96)
Évoquant l’histoire des trois casseurs de pierres, l’auteur associe le développement d’une pensée positive à celle de mettre du sens dans ses actions : « Il n’y a de sens que si je veux qu’il y en ait un. [Or] le sens est une boussole qui nous met en chemin, il n’est pas un GPS » (2020 : 114-115). Ce sens devrait nous amener à sortir de notre zone de confort pour nous inviter à la créativité (3ème principe), en dépassant nos pensées limitantes :
« La crise nous invite en effet à sortir de ce que l’on connaît déjà et, d’une certaine manière, à penser contre soi – contre ses acquis, contre ses préjugés, contre tout ce qui nous immobilise, contre la répétition de nos manières de faire, d’avancer, de penser, que nous prenons pour des vérités mais qui ne sont que des croyances. » (2020 : 122-123)
7. Faire le bien
L’auteur conclut son cheminement par la théorie du don et du contre-don de Marcel Mauss : « [Le don] crée une communauté qui donne du courage, de la confiance, du bonheur à celui qui donne et à celui qui reçoit, pour aller de l’avant » (2020 : 146).
Dépassant les « discussions de salon où l’on s’interroge pour savoir si l’être humain est fondamentalement altruiste ou égoïste » (2020 : 149), Fabrice Midal fait ainsi l’éloge de l’altérité, à commencer par sa propre altérité :
« Ce premier pas, je l’ai personnellement effectué sur un tapis de méditation, auprès de maîtres qui m’ont appris un geste essentiel : dire bonjour à tout ce qui me fait don de sa visite, une angoisse, un mal de dos, une intuition, mes faiblesses, mes forces, le bruit de la rue… Je ne cherchais ni à les contrôler, ni à les interroger, simplement à les reconnaître. » (2020 : 147)
S’agirait-il d’accueillir pour finalement recevoir, en retour, un enseignement, une forme de liberté retrouvée, une croissance personnelle ?

0 commentaires