Un merveilleux malheur
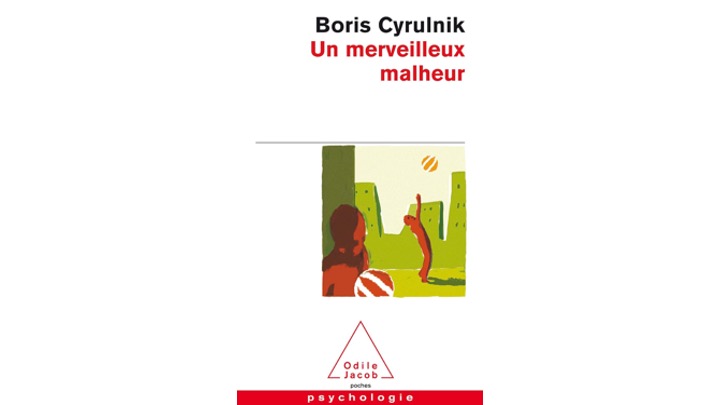
Références:
Cyrulnik, Boris
Un merveilleux malheur
Odile Jacob
2002
Résumé
Dans cet ouvrage quelque peu fouillis, Boris Cyrulnik, à qui l’on doit largement la diffusion du concept de résilience en Europe francophone, présente les principaux éléments de la résilience, en prenant principalement pour exemple les enfants ayant vécu de puissants traumatismes. Sans prétendre résumer ici l’ensemble des réflexions de l’auteur, voici toutefois quelques concepts qui peuvent être mis en exergue en regard de la résilience.
L’auteur définit cette dernière, en s’inspirant de celle de S. Vanistendael, comme « la capacité à réussir, à vivre et à se développer positivement, de manière socialement acceptable, en dépit du stress ou d’une adversité qui comportent normalement le risque grave d’une issue négative » (2002 : 8).
L’adversité connaît des gradations et des barèmes
Mais nous ne sommes pas tous égaux face aux événements traumatiques
Les événements sont différemment vécus selon le moment ou le contexte dans lesquels ils se produisent :
- perdre sa mère à six mois, à six ans, ou à soixante ans, n’est pas égal ;
- traverser un divorce alors que l’on rencontre des problèmes importants au niveau de sa santé ou de son travail peut être plus difficile que s’il intervient dans un environnement favorable et soutenant.
De même, un traumatisme spectaculaire peut être moins dégradant qu’un « traumatisme chronique, insidieux mais répété » (2002 : 59), et cela d’autant plus s’il intervient dans une période de construction de son identité propre (enfance).
Il existerait des barèmes des traumatismes, allant de la mort de son conjoint à la retraite ou à la perte de son emploi, en passant par le divorce ou le mariage. Même les vacances, les fêtes de Noël et les contraventions pourraient être classées dans ce barème des traumatismes, certes à des gradients faibles. Mais l’auteur s’empresse de préciser un point : « Pour comprendre la résilience, le ressort intime face aux coups de l’existence, il faut s’intéresser à ceux qui ne confirment pas ce barème » (2002 : 36) :
« Finalement, le barème des traumatismes donne une vague approximation. On peut sans peine admettre que la perte du conjoint nous choque un peu plus qu’une contravention, mais ayant dit cela, on n’a pas dit grand-chose, surtout quand on a l’occasion de côtoyer des victimes aux rebonds surprenants.
Plutôt que poser le problème en termes de cause unique qui provoque un effet évaluable, la notion de résilience cherche à comprendre de quelle manière un coup peut être encaissé, peut provoquer des effets variables et même un rebond. » (2002 : 38)
Les traumatismes seraient variablement vécus en fonction du passé, du contexte et du degré de résilience de la personne. Une personne qui aurait appris à avoir faim supportera mieux une période de jeûne imposé qu’une personne qui ne l’aurait jamais expérimenté jusque-là. Et « ce n’est pas l’objectivité d’une situation qui nous éprouve le plus : la faim, le froid, les coups jouent un rôle, bien sûr, puisqu’ils nous contraignent à l’immédiateté de manger, de se réchauffer ou de se protéger. Mais notre monde psychique est façonné par nos représentations où les repères charpentent notre monde intérieur » (2002 : 33).
L’auteur donne différents exemples de facteurs de résilience internes et externes dont on disposerait ou dont on serait doté, et qui détermineraient la capacité à résister ou à rebondir. Il présente par exemple une étude menée dans l’île de Kawaï (près d’Hawaii), où « deux cents enfants en grave situation de risque parental et social ont été suivis régulièrement » (2002 : 14), et où, si 130 enfants ont connu une évolution catastrophique, 70 ont connu un développement favorable en dépit des circonstances. Ainsi, le passé, les souvenirs et les expériences d’une personne façonneraient sa perception du présent, mais ne le détermineraient pas.
Le déni et le clivage
Le déni, tout comme la haine, est un mécanisme de défense, qui peut être sain s’il ne dure pas.
Le clivage, qui découle d’un déni qui s’éternise, est quant à lui défini comme une « amputation partielle de la personnalité qui permet à la partie non meurtrie de l’individu de s’exprimer encore, de manière socialement acceptable » (2002 : 152-153). Il provient souvent du silence, de l’incapacité à exprimer les événements traumatisants, avec pour effet de jouer un rôle social de façade. Rompre le silence (cf. Enjolet 1999) devient alors le moyen de sortir de l’ornière du clivage : « […] Le clivage de la personnalité : une partie transparente sociale et souvent gaie masque une partie noire, secrète et honteuse. Le simple fait de le dire et de l’écrire raccommode les deux parties du moi divisé » (2002 : 119).
Au déni et au clivage, on pourrait associer le diktat de vivre l’instant présent : « Vivez dans l’immédiat et tout ira mieux, affirment ceux qui n’ont jamais eu à se poser la question » (2002 : 144). Il s’agirait dans ce cas de promouvoir une forme d’amnésie (clivage) ou de lobotomie (cessant alors d’anticiper), alors même que « la représentation nécessite une intégration du temps. Tout évènement correctement perçu doit être situé. C’est en le comparant aux circonstances antérieures que l’évènement prend sens » (2002 : 145). Finalement, l’auteur observe que celui qui n’a ni passé (amnésie) ni futur (lobotomie) deviendrait prisonnier du présent : « Celui qui n’habite pas le temps passé ou à venir se soumet au présent » (2002 : 148).
Le récit, la sublimation, le rêve et l’humour comme outils de réparation
La mise en récit est une opération nécessaire pour mettre du sens parmi les événements traumatiques : « Les images sont insensées quand on ne peut pas les situer et en faire un récit » (2002 : 28) ; « “Tous les chagrins sont supportables si on en fait un récit” » (2002 : 105) :
« Le malheur n’est jamais pur, pas plus que le bonheur. Mais dès qu’on fait un récit, on donne sens à nos souffrances, on comprend, longtemps après, comment on a pu changer un malheur en merveille […]. » (2002 : 8)
Or, cette mise en récit ne se veut pas objective, mais salutaire et signifiante. Et pour se faire, elle a parfois non seulement besoin de subjectivité, mais de créativité : « Quand le réel est terrifiant, la rêverie donne un espoir fou. À Auschwitz ou lors de la guerre du Pacifique, le surhomme était un poète » (2002 : 24), faisant de la poésie « une arme de survie » (2002 : 36) et du poète celui « qui parvient à se réfugier dans un monde intérieur » (2002 : 37).
« […] Presque tous ceux qui sont s’en sortis ont élaboré, très tôt, une “théorie de vie” qui associait le rêve et l’intellectualisation. Presque tous les enfants résilients ont eu à répondre à deux questions. “Pourquoi dois-je tant souffrir ?” les a poussés à intellectualiser. “Comment vais-je faire pour être heureux quand même ?” les a invités à rêver. » (2002 : 15)
Ce constat expliquerait que nombre d’artistes et d’écrivains ont été des écorchés de la vie :
« Parmi les réactions de défense qui poussent les agressés à rebondir, la créativité constitue un très bel outil qui les invite à participer à l’aventure culturelle. […] Entre la contrainte intérieure qui les pousse à parler et la force extérieure qui les oblige à se taire, les âmes altérées découvrent souvent que la créativité devient leur meilleur moyen d’expression. » (2002 : 174)
« L’écriture rassemble en une seule activité le maximum de mécanismes de défense : l’intellectualisation, la rêverie, la rationalisation et la sublimation. » (2002 : 178)
La sublimation prend forme « quand la force de vivre est orientée vers des activités socialement valorisées, comme les activités artistiques, intellectuelles ou morales » (2002 : 83). L’altruisme (voire le militantisme) en serait une expression fréquente ; le développement de la spiritualité en serait une autre.
L’humour serait enfin un puissant outil de résilience. L’auteur donne l’exemple du film La vita e bella (1998), de Roberto Benigni, qui n’est pas « la dérision d’Auschwitz, mais au contraire […] une mise en scène de la fonction protectrice de l’humour » (2002 : 11). L’humour permettrait de prendre de la distance, de « moins se laisser entamer par l’épreuve (2002 : 83).
Le récit serait donc un outil de résilience presque incontournable : « Après l’angoisse de l’aveu, parlé ou écrit, on éprouve souvent un étonnant apaisement, [donnant] soudain un sentiment de cohérence et d’acceptation » (2002 : 106), donnant un sens aux événements de manière subjective, à tel point que « quand on raconte son passé, on ne le revit pas, on le reconstruit » (2002 : 110). Le récit rompt le silence et met du sens.
Mais cette reconstruction doit avoir des limites, car à trop réinventer le passé, on deviendrait prisonnier d’un mensonge ou d’un ressassement négatif (menant à un besoin de vengeance) : « L’abus de mémoire pétrifie l’avenir et contraint à la répétition, encore plus que l’oubli. Travailler à comprendre l’histoire, et non pas à l’utiliser, permet d’associer la mémoire qui donne sens avec la désobéissance au passé qui invite à l’innovation » (2002 : 125).
L’exemple de la délinquance comme outil de résilience
Outre le mensonge, l’environnement peut contrarier une résilience. À titre d’exemple, l’auteur évoque le cas d’orphelins précoces qui ne peuvent pas trouver un terrain d’expression (peinture, théâtre, écriture…), absence de véhicule d’expression qui les conduit presque naturellement à la délinquance.
Ces jeunes malmenés par la société, confrontés aux échecs scolaires, au chômage, etc., peuvent se tourner vers la délinquance, utilisée comme outil de résilience. Grâce au deal, qui leur permet de gagner très rapidement de l’argent, et grâce au sentiment d’appartenance à un groupe qu’alimentent leurs chefs, ces jeunes reconquièrent une dignité que le système social n’a pas su leur restituer : « Ils deviennent résilients grâce à la délinquance » (2002 : 17).
Les adjuvants des traumatismes
L’isolement est un adjuvant patent du traumatisme. A titre d’exemple, « plus un migrant est seul, plus il est anxieux, ce qui se traduit par un chiffre plus élevé de consommation médicale et de passages à l’acte illégaux » (2002 : 44). L’auteur ajoute sur ce point que « deux stratégies sociales extrêmes semblent toxiques pour ces populations : l’isolement et l’assimilation. […] L’assimilation semble aussi toxique, puisqu’elle passe ce contrat avec les migrants : devenez comme nous-mêmes, renoncez à votre mémoire, alors seulement nous vous accueillerons. Or, les amnésiques ne peuvent pas donner sens à ce qu’ils perçoivent » (2002 : 45).
Paradoxalement, l’environnement social peut être aussi toxique que l’isolement. Une société qui voit une femme, ayant subi un viol, comme impure (représentation sociale) devient une entrave à la résilience. De même, une forme d’effet pygmalion peut être à l’œuvre : « Quand la majorité d’une population d’enfants abandonnés produit des délinquants, ça ne veut pas dire que la carence affective mène à la délinquance. Cela suggère plutôt que la société, en récitant que “tout enfant sans famille est une mauvaise graine”, organise des circuits sociaux qui les tricotent vers la délinquance » (2002 : 100).
Parallèlement, un besoin trop important de retrouver un sentiment d’appartenance peut faire rejoindre un groupe entravant la résilience, voire l’aggravant (comme ces jeunes qui s’engagent dans des groupes de délinquants, où ils retrouvent paradoxalement une forme d’estime de soi et de fierté).
Enfin, après une rupture, on pourrait être tenté de se remettre avec le premier venu, avec le risque d’entraver sa résilience, voire d’aggraver la situation : « Quand on se noie, on s’accroche à n’importe quelle planche », 2002 : 94).
Les tuteurs de résilience
Les tuteurs de résilience, tantôt initiateurs, tantôt étoiles du berger, peuvent être déterminants : les amis, le conjoint, la famille, le professeur, l’infirmière, etc., peuvent être de puissants étayages. Ainsi, aux facteurs internes de résilience s’ajoutent les facteurs externes : « Alors se tricote la résilience. Elle n’est pas à rechercher seulement à l’intérieur de la personne, ni dans son entourage, mais entre les deux, parce qu’elle noue sans cesse un devenir intime avec le devenir social » (2002 : 186).
Mais, du côté des tuteurs eux-mêmes, le risque de transfert est quant à lui un facteur sensible : « […] Les proches des traumatisés dont ils partagent les émotions et dont ils éprouvent les souffrances sont souvent plus altérés que les blessés eux-mêmes » (2002 : 162) :
« Il n’est pas difficile d’expliquer cette transmission psychique d’un trouble organique. Le parent traumatisé s’adapte à la meurtrissure par des mécanismes de défense coûteux mais efficaces : le clivage de la personnalité, le déni de mémoire, la compensation par la rêverie, le militantisme et l’altruisme sont les plus classiques. […] Quand le blessé a dû affronter le réel, le proche, lui, a lutté contre un fantôme. » (2002 : 163-164)
Ce qui fait dire à l’auteur que « partager son malheur, c’est altérer ses proches » (2002 : 165), ce qui conduit au paradoxe du secret insupportable ou de son partage risqué, si l’autre ne le supporte pas : « La confidence, au sens banal du terme, possède un étonnant pouvoir protecteur, à condition que le sujet qui confie son secret se sente en confiance » (2002 : 172-173).
Le mirage de la résilience
Rebondir n’est pas encore être heureux
Certes, des événements traumatiques peuvent finalement développer le caractère, offrir des possibilités de grandir, d’évoluer, mais cela aurait aussi un coût dont il ne faudrait pas sous-estimer le prix. Le vainqueur d’un traumatisme n’en resterait pas moins blessé : un « vainqueur blessé » (2002 :21). Ainsi, l’auteur, lorsqu’il évoque La vita e bella (1998) comme exemple de fonction protectrice de l’humour, ajoute également son prix. Rappelant la dernière phrase du film (« c’est à en mourir de rire »), il souligne « l’ambivalence des mécanismes de défense : ils nous protègent, mais on les paie » (2002 : 11). C’est le sens de l’oxymore du titre Un merveilleux malheur :
« […] Toute situation extrême, en tant que processus de destruction de la vie, renferme paradoxalement un potentiel de vie, précisément là où la vie s’était brisée […]. Le ressort invisible […] permet de rebondir dans l’épreuve en faisant de l’obstacle un tremplin, de la fragilité une richesse, de la faiblesse une force, des impossibilités un ensemble de possibles. » (Fischer, G. 1994 : Le ressort invisible. Vivre l’extrême, Paris, Seuil, p. 269, cité par Cyrulnik, B. 2002 : 185)
Les événements traumatisants ont donc presque nécessairement comme effet une mue, une mutation, une métamorphose : ils forcent au changement.
Ainsi, lorsque Boris Cyrulnik parle d’un « merveilleux malheur », il présente la résilience comme un oxymore, emblème d’une personne blessée mais résistante, qui souffre mais reste capable d’être debout en dépit des évènements traumatisant qu’elle a dû affronter : « Pour ceux qui ont surmonté l’épreuve, le malheur devient l’étoile du berger qui oriente vers le miracle […]. Un malheur n’est jamais merveilleux. C’est une fange glacée, une boue noire, une escarre de douleur qui nous oblige à faire un choix : nous y soumettre ou le surmonter. La résilience définit le ressort de ceux qui, ayant reçu le coup, ont pu le dépasser. » (2002 : 21). Être résiliant ne signifie donc pas être invincible, invulnérable ou encore indemne. « […] Le fait de représenter la résilience par la métaphore du tricot élimine la notion de force ou de faiblesse de l’individu. Ce qui n’a rien à voir avec la vulnérabilité ou l’invulnérabilité […] » (2002 : 186) :
« Ni acier ni surhomme, le résilient ne peut pas échapper à l’oxymoron dont la perle de l’huître pourrait être l’emblème : quand un grain de sable pénètre dans une huître et l’agresse au point que, pour s’en défendre, elle doit sécréter la nacre arrondie, cette réaction de défense donne un bijou dur, brillant et précieux. » (2002 : 187)
Et être résiliant ne signifie pas non plus être heureux : « [J’ai] appris à transformer le malheur en épreuve. Si l’un fait baisser la tête, l’autre la relève » (Enjolet 1999 : 95). Mais cela ne se traduit pas par le bonheur. Évoquant Bettelheim, l’auteur rappelle que la résilience « désigne ce qui fait rebondir aux coups du sort et non pas une aptitude au bonheur » (2002 : 50).
En conclusion, « l’enjeu de ce livre a été simplement de dire que la résilience existe. Elle a une forme et coûte un prix » (2002 : 187), et sa présence ne garantit pas encore le bonheur.

0 commentaires